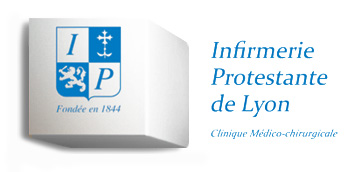La prise en charge du cancer des voies biliaires
Les symptômes du cancer des voies biliaires
Plusieurs symptômes peuvent traduire la naissance d’une tumeur de la vésicule biliaire :
Comment diagnostiquer un cancer des canaux biliaires ?
Plusieurs examens d’imagerie médicale peuvent permettre de détecter le cancer et d’évaluer son stade. Les praticiens en gastro-entérologie pourront donc soumettre les patients à :
Traitement du cancer des voies biliaires à Lyon
L’intervention chirurgicale est nécessaire pour retirer la tumeur cancéreuse et traiter les tissus voisins. Pour que l’intervention soit possible, il faut que la pathologie ne soit pas à un stade trop avancé.